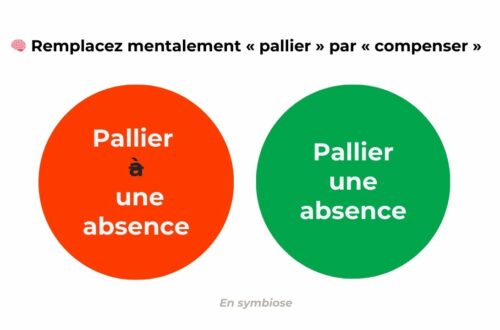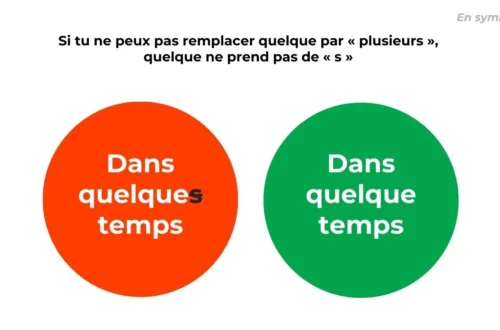La règle oubliée
Lorsque le verbe convenir signifie « se mettre d’accord », il exige impérativement l’auxiliaire être. Eh oui, la forme correcte est donc : « Nous étions convenus de reporter le projet », « Ils étaient convenus d’un nouveau délai ».
Cette règle découle du double emploi du verbe convenir :
• Convenir de = se mettre d’accord → auxiliaire être
- ✅ Nous sommes convenus de nous retrouver à 14h
- ✅ Ils étaient convenus d’une stratégie commune
• Convenir à = correspondre, être adapté → auxiliaire avoir
- ✅ Cette solution m’a convenu parfaitement
- ✅ L’horaire ne lui avait pas convenu
À retenir : Se mettre d’accord = être / Correspondre = avoir
Anatomie d’une faute virale
Comment cette erreur a-t-elle pu se propager si massivement ? Plusieurs mécanismes linguistiques l’expliquent.
L’hégémonie de « avoir »
Dans la conjugaison française, l’auxiliaire avoir domine largement. Nous disons naturellement « nous avons décidé », « nous avons choisi », « nous avons prévu ». Par automatisme, le cerveau applique ce schéma familier à convenir, créant la forme fautive « nous avons convenu ».
Le mimétisme social
Plus une erreur circule, plus elle paraît légitime. Quand des cadres dirigeants, des journalistes ou des responsables politiques emploient « nous avons convenu », cette tournure acquiert une respectabilité trompeuse. L’usage incorrect se normalise par simple exposition répétée.
C’est un peu la même chose pour au jour d’aujourd’hui (qui est un pléonsame) ou pour contreverse (qui n’existe pas comme ça)
L’autorité de la norme
L’Académie française demeure catégorique : « Le verbe convenir, au sens de « tomber d’accord », se conjugue avec l’auxiliaire être ». Cette position, confirmée par les grammairiens de référence comme Grevisse, ne souffre aucune exception.
Maurice Grevisse, dans Le Bon Usage, précise même que cette règle s’applique « quelle que soit la fréquence de l’usage contraire dans la langue parlée ». Autrement dit, la norme résiste, malgré la pression de l’usage.
Stratégies d’évitement
Pour ceux qui doutent encore, plusieurs alternatives permettent d’éviter l’écueil :
- « Nous nous sommes entendus pour… »
- « Nous avons décidé ensemble de… »
- « Il a été décidé que… »
- « Nous sommes tombés d’accord sur… »
Ces formulations, plus longues mais plus sûres, préservent l’élégance tout en contournant la difficulté grammaticale.
🧩 Mini-quiz
Corrigez ces phrases :
- « Nous avons convenu de nous revoir demain »
- « Cette méthode m’est convenue »
- « Ils ont convenu d’un compromis »
Réponses : 1. étions convenus / 2. a convenu / 3. étaient convenus
Entre purisme et pragmatisme
Faut-il pour autant dramatiser ? Non, bien sûr. La langue évolue, et certains usages finissent par s’imposer malgré les résistances normatives. Cependant, dans les contextes dans lesquels la précision linguistique reste valorisée : écrits professionnels, textes officiels, communications formelles, respecter cette distinction révèle une maîtrise qui peut faire la différence.
En résumé
« Nous avons convenu de » s’entend partout, s’écrit couramment, se banalise quotidiennement. Pourtant, cette tournure reste fautive selon les règles académiques. Entre « nous sommes convenus » (correct) et « nous avons convenu » (incorrect, mais répandu), chacun choisira selon ses priorités : suivre l’usage majoritaire ou respecter la norme établie.
Une certitude demeure : connaître cette distinction, c’est disposer d’un outil supplémentaire pour naviguer avec finesse dans les nuances de notre langue. Car maîtriser le français, c’est aussi savoir quand et comment transgresser ses règles en connaissance de cause.
Mais, imaginez la scène : vous dites : « Jeudi, nous sommes convenus de nous voir à 10h » et votre collègue vous reprend aussitôt : « Attention, on dit : nous AVONS convenu ! » Gênant… car c’est exactement l’inverse. Vous veniez d’employer la forme correcte, et on vous a « corrigé » avec une erreur.
Cette situation cocasse illustre parfaitement l’ampleur du problème : l’erreur est devenue si courante qu’elle passe pour la norme et la règle juste pour une faute.
D’autres subtilités d’orthographe :